Analyse : Comment le tsunami Trump a frappé en Asie

© Istock
Les nouveaux droits de douane décrétés par le président américain Donald Trump le 2 avril ont provoqué une onde de choc dans le monde entier. Mais en Asie, il a pris la forme d’un véritable tsunami, nous explique Sophie Wieviorka, économiste spécialiste de l’Asie au service des études du Crédit Agricole. Dans cet article, elle passe en revue les premiers impacts.
Les annonces de l’administration Trump sur les nouveaux droits de douane imposés à partir du 5 avril ont plongé les pays asiatiques dans un état de sidération. Les montants annoncés y sont particulièrement élevés, notamment pour des pays qui avaient profité de la première guerre commerciale initiée sous Trump I et vu leurs exportations vers les États-Unis augmenter rapidement.
Tous les pays asiatiques, de la Chine au Japon en passant par la Corée du Sud, la Thaïlande ou le Vietnam, ont indiqué leur volonté de négocier avec les États-Unis pour parvenir à un meilleur accord. Le risque d’escalade est réel, notamment du côté chinois, mais les pays d’Asie ne seront pas tous en position de force pour obtenir des concessions.
Comment « les droits réciproques » ont-ils été calculés ?

En présentant son tableau de « tarifs réciproques », Donald Trump a expliqué que « réciproque veut dire que tout ce qu’ils nous font à nous, nous leur faisons à eux », ajoutant que tout cela était « très simple, ça ne pourrait pas être plus simple que ça ».
Pourtant, le tableau présente des montants très éloignés des chiffres circulant habituellement, collectés auprès de l’OMC ou des administrations douanières des pays. Les taux affichés prennent supposément en compte les droits de douane imposés par le pays sur les importations de produits en provenance des États-Unis, mais aussi les « manipulations de change » et d’autres barrières tarifaires.
En réalité, il semblerait qu’une tout autre formule, qui n’a aucun sens sur le plan économique, ait été appliquée : prendre le déficit commercial (sur les biens uniquement) des États-Unis vis-à-vis du pays et le diviser par le montant total des importations américaines en provenance de ce pays. Diviser ensuite ce taux par deux pour obtenir les « droits réciproques supplémentaires » qui doivent entrer en vigueur entre le 5 et le 9 avril.
Les pays asiatiques apparaissent particulièrement pénalisés car ils cumulent généralement de hauts niveaux d’excédents vis-à-vis des États-Unis et de faibles montants d’importations. De plus, les niveaux de droits de douane appliqués y sont souvent supérieurs à ceux des droits américains, même si cet indicateur ne semble en réalité pas avoir été pris en compte pour déterminer les fameux tarifs réciproques.
La décision spécifique sur le secteur automobile (25 % de droits sur les véhicules et les pièces détachées) est aussi un coup pour le Japon et la Corée, dont les exportations cumulées de voitures vers les États-Unis dépassaient les 70 milliards de dollars en 2024.
En revanche, les exemptions annoncées (qui pourraient cependant faire l’objet de futures mesures) pour les semi-conducteurs et la pharmacie, notamment, sont un léger soulagement, en particulier pour l’Inde qui craignait pour son secteur pharmaceutique, extrêmement dépendant du marché américain.
Ex. Grands gagnants de la première guerre commerciale de Donald Trump
De fait, les pays asiatiques hors Chine avaient été parmi les grands gagnants de la recomposition des chaînes de valeur après la première phase de guerre commerciale observée sous l’administration Trump I.

Le Vietnam, Taïwan, la Corée du Sud, la Thaïlande et l’Inde ont ainsi vu leur excédent commercial doubler, voire tripler, entre 2017 et 2024. Cumulé, l’excédent des pays d’Asie hors Chine vis-à-vis des États-Unis dépasse les 460 milliards de dollars, plus du tiers du déficit commercial total. Surtout, il a progressé de plus de 250 milliards de dollars depuis 2017, alors que le déficit américain à l’égard de la Chine ne baissait que de 80 milliards de dollars.
Certains pays, en particulier le Vietnam et la Thaïlande, ont surtout servi de plateforme de contournement des droits de douane imposés par les États-Unis sur les produits chinois.
Leurs importations en provenance de Chine ont ainsi suivi une trajectoire semblable à celles des exportations vers les États-Unis, créant une situation de double dépendance impliquant des pans entiers de leurs économies et les emplois associés. Même si les tâches effectuées hors de Chine se concentrent parfois sur l’assemblage ou dans des secteurs comme le textile, où la valeur ajoutée est assez faible, un net ralentissement du commerce international viendrait affaiblir l’écosystème créé, notamment sur le plan de l’emploi.
La part des exportations vers les États-Unis représentait ainsi 25,1% du PIB vietnamien en 2024, 13,9 % du PIB taïwanais et plus de 10 % des PIB thaïlandais ou malais.
Le temps de la négociation ou de l’escalade ?
On l’a compris, les droits de douane sont brandis par Donald Trump comme une arme de négociation dépassant parfois largement le cadre commercial ou celui de la relation économique entre les États-Unis et le pays concerné. Mais face à cette menace, les pays d’Asie sont loin d’être égaux dans des négociations au cas par cas qui s’annoncent pour le moins tendues.

Première question à trancher : bien que les États-Unis se soustraient allègrement aux principes de l’OMC, les pays qui souhaitent continuer à jouer le jeu du multilatéralisme et qui ne sont pas liés par un accord de libre-échange avec les États-Unis ne peuvent théoriquement pas augmenter leurs droits de douane pour un seul de leur partenaire, et doivent continuer d’appliquer la clause de la nation la plus favorisée. Cela signifie que les pays doivent maintenant choisir entre augmenter leurs droits de douane pour tous leurs partenaires ou bien sortir des règles de l’OMC.
Là est tout le paradoxe : les pays ont beau s’affranchir des règles du commerce international, l’année 2024 a enregistré un nombre de plaintes record.
La Chine, qui souhaite se placer comme défenseur du système multilatéral, agit avec la plus grande prudence. Jusqu’à présent, elle avait répliqué de manière mesurée et nuancée sur certains produits américains qui violent selon elle les règles de l’OMC (notamment en matière de subventions). Le ministre du Commerce chinois avait réagi aux nouvelles annonces en demandant le retrait immédiat des droits de douane, et l’ouverture d’un dialogue sur le sujet. Il a finalement annoncé des droits de douane supplémentaires de 34 %, qui entreront en vigueur le 10 avril, et de nouveaux contrôles sur les exportations de certaines terres rares.
C’est sûrement la deuxième question : faut-il répliquer immédiatement par des droits de douane puis lancer les négociations, ou bien jouer l’apaisement ?
La première phase de la guerre commerciale a livré un enseignement : une fois appliqués pendant un certain temps, les droits de douane sont généralement rigides. Ainsi, la signature de l’Accord Phase-1 entre la Chine et les États-Unis en 2020 n’avait pas conduit au retrait des droits imposés entre 2016 et 2018. Le risque est évidemment celui de l’escalade désordonnée, qui conduirait à une inflation des mesures tarifaires et non-tarifaires, avec toute la désorganisation logistique qu’elles impliqueraient.
Dans leur tradition de pragmatisme commercial – soulignons par exemple que la semaine dernière Japon, Corée du Sud et Chine se sont tout de même réunis pour relancer les négociations autour d’un traité de libre-échange plus ample que le partenariat économique régional global signé en 2020 *, alors que le secrétaire d’État à la Défense américain en visite à Tokyo et son homologue japonais rappelaient l’alliance militaire liant les deux pays – les pays d’Asie tendent à favoriser la négociation plutôt que l’escalade, mais que peuvent-ils offrir aux États-Unis ?
Qu’ont-ils à proposer aux Américains ?
C’est la troisième question : que proposer aux Américains ? C’est peut-être sur ce point que les pays d’Asie sont les plus inégaux.

En haut de l’échelle, la Corée du Sud, le Japon et Taïwan. Ces trois économies ont certes des excédents – et plutôt conséquents dans le cas de la Corée du Sud et de Taïwan – mais elles ont aussi des marges de négociations que n’a pas le reste de l’Asie. Déjà, des entreprises capables d’investir aux États-Unis, et de manière substantielle. 100 milliards annoncés pour TSMC, 21 milliards pour Hyundai et des investissements japonais au plus haut en 2024 (74 milliards de dollars).
Ensuite, ces trois pays sont vieillissants et plus contraints en termes d’espace : leur population active diminue, et l’ouverture de nouveaux sites de production est compliquée par le manque de terrains. Les biens exportés présentent en outre une valeur ajoutée et un niveau de qualité élevé, plus difficilement substituable, notamment dans le secteur des semi-conducteurs et de l’électronique.
Ces pays sont en mesure d’augmenter leurs importations en provenance des États-Unis, et donc de rééquilibrer leur balance commerciale, car ils importent des biens produits par les États-Unis (produits agricoles, énergie, aéronautique) même s’il semble peu probable qu’ils parviennent à augmenter suffisamment leurs achats pour effacer leur excédent. Notons enfin que, même si l’administration Trump ne prend pas en compte ce point, la balance des services de ces économies vis-à-vis des États-Unis est déficitaire.
Enfin, et si l’on sort de l’aspect purement économique, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan sont aussi militairement proches des États-Unis, même si Trump a souvent répété que la présence américaine en Corée du Sud et au Japon coûtait trop cher. Un autre axe de négociation serait donc d’augmenter un peu plus les budgets militaires et les achats d’armes et d’équipements américains.
Et quid de la Chine ?
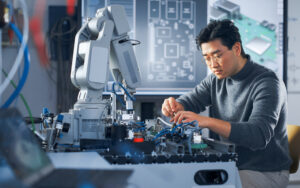
Ensuite, la Chine. Il est peu probable de voir des entreprises chinoises venir s’installer aux États-Unis. Ce n’est en tout cas pas le mouvement qui avait été observé entre 2016 et 2020, phase durant laquelle les entreprises chinoises étaient plutôt passées par des marchés tiers (Mexique, Vietnam) pour contourner les droits, ne serait-ce que pour des questions de compétitivité-prix.
La Chine pourrait aussi s’engager à augmenter ses achats de produits américains, mais l’échec de l’Accord Phase-1 de 2020, qui portait justement sur ce point, conduit à penser que les États-Unis auront sûrement du mal à accepter ce genre de « deal ». Dernière possibilité, celle d’un accord bien plus large englobant des aspects géopolitiques, par exemple pour impliquer la Chine dans des négociations de paix avec la Russie.
Il existe aussi évidemment des cartes côté chinois : hausse équivalente des tarifs, notamment sur les produits agricoles, et surtout restriction sur les exportations de terres rares, dont les États-Unis demeurent très dépendants.
Les pays de l’Asean mal positionnés
Les pays de l’Asean (hors Singapour) sont sans doute les plus mal positionnés pour négocier, en particulier le Vietnam et la Thaïlande.

Coincés entre la Chine et les États-Unis sur le plan commercial, ayant fondé leur modèle de croissance sur l’ouverture et l’insertion dans les chaînes de valeur, leur niveau de développement – et celui de leurs entreprises – ne leur permet cependant pas de proposer, comme les entreprises taïwanaises ou coréennes, d’investir aux États-Unis. Avec un secteur exportateur s’appuyant essentiellement sur de la compétitivité-prix et l’impératif de fournir des emplois à des populations toujours en croissance, cette stratégie paraît extrêmement peu probable.
Ouverts aux exportations… mais encore protectionnistes et appliquant des niveaux de droits de douane en moyenne plus élevés que les États-Unis (c’est la justification de départ pour imposer des tarifs réciproques), ils sont aussi limités dans les achats potentiels de produits américains pour rééquilibrer leur balance commerciale.
Le Vietnam, par exemple, a exporté pour 142 milliards de dollars de biens en 2024, et importé pour 13 milliards ; le pays pourra certes acheter un peu plus de gaz liquéfié américain, de coton ou autres produits agricoles, voire renouveler sa flotte de Boeing, mais jamais jusqu’au point d’équilibre.
Le risque pour ces « petites » économies sera aussi de ne pas être prioritaires pour négocier avec le ministère du Commerce américain. Et donc de voir celle qui aura négocié le mieux et le plus vite récupérer une partie de l’activité d’exportation de ses voisins, surtout dans les secteurs intenses en main-d’œuvre mais pas en capital (assemblage, textile, ameublement…).
Et l’Inde dans tout ça ?
Enfin, reste le cas de l’Inde.

Le Premier ministre Narendra Modi comptait sûrement sur la « relation spéciale » qu’il pensait avoir avec Donald Trump pour échapper à la foudre, il n’aura qu’une exemption – peut-être temporaire – sur l’industrie pharmaceutique (15 % des exportations indiennes vers les États-Unis tout de même).
Très protectionniste, l’Inde devra surtout gérer la délicate question du secteur agricole, encore au cœur de son économie, sur lequel toutes les négociations d’accords commerciaux ont jusqu’ici achoppé. Comme la Corée du Sud ou le Japon, c’est peut-être sur d’autres terrains que celui de l’économie que se conclura le deal.
Ouverts, intégrés, les pays d’Asie ont prospéré sur les racines de la « mondialisation heureuse » dont Trump a probablement sonné le glas ce 2 avril 2025. Alors que la phase – intense – de négociations commence, le risque sera de voir une concurrence effrénée se produire entre tous ces pays – dont certains sont pourtant liés commercialement au sein de l’Asean – et conduire à l’éclatement total des règles multilatérales du commerce, dont ces pays ont pourtant profité depuis vingt ans.
Sophie Wieviorka
Economiste – Asie (hors Japon)
*Cet accord (RCEP) rassemble les pays de l’Asean, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande
